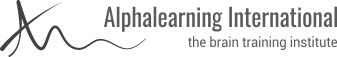Mécanismes du Neurofeedback
On peut affirmer sans crainte que le Neurofeedback demeure largement méconnu du grand public. Certes, quelques professionnels visionnaires développent des recherches dans ce domaine, mais leur nombre reste très limité. Dans de nombreux pays, la production scientifique en la matière est pratiquement inexistante, perpétuant une ignorance même au sein du milieu universitaire. Dans quelques autres, en revanche, les publications sur le Neurofeedback se comptent déjà par centaines.
L’article suivant vous informera des principes fondamentaux du Neurofeedback.
Aperçu des mécanismes du Neurofeedback
Définir le programme de recherche
par Siegfried Othmer, Ph.D.
Directeur scientifique, The EEG Institute
Octobre 2003 (révisé en juillet 2007)
Dans ce qui suit, les références portent non seulement sur les applications du Neurofeedback, mais aussi sur les mécanismes d’autorégulation du cerveau qui sous-tendent le retour d’information EEG (Neurofeedback).
Les domaines d’application concernent en particulier le trouble du déficit de l’attention, le spectre anxiété-dépression, les crises épileptiques et les addictions. Nous présentons les articles clés dans les principaux domaines d’application, ainsi que des travaux préliminaires qui mettent en évidence de nouvelles perspectives : les troubles du comportement perturbateur, tels que le trouble oppositionnel avec provocation (TOP) et le trouble des conduites ; le spectre de l’autisme et le syndrome d’Asperger ; le trouble bipolaire ; les troubles spécifiques des apprentissages, dont la dyslexie ; les troubles du sommeil ; les traumatismes crâniens et accidents vasculaires cérébraux (AVC) ; le trouble de stress post-traumatique (TSPT) ; les problématiques féminines telles que le syndrome prémenstruel (SPM) et la ménopause ; les questions liées au vieillissement, comme le parkinsonisme et la démence, ainsi que le déclin cognitif lié à l’âge ; et, enfin, les syndromes douloureux comme la migraine, ainsi que la prise en charge de la douleur chronique.
Neuro-régulation dans le domaine bioélectrique
D’autres références portent sur les mécanismes cérébraux qui sous-tendent le retour d’information EEG (Neurofeedback). Il s’agit essentiellement des mécanismes de neurorégulation dans le domaine bioélectrique, un champ d’étude relativement récent au sein des neurosciences. Le cerveau doit être considéré comme un réseau interactif dont le fonctionnement repose sur une synchronisation temporelle précise. Les processus par lesquels le cerveau organise et façonne sa propre synchronisation doivent donc être parfaitement compris. Cela implique en premier lieu le modèle des réseaux « small-world » (ou « petit monde »), qui soutient le haut niveau d’intégration fonctionnelle observé, ainsi que la structure hiérarchique de la régulation. Il s’agit également du modèle de « time binding » pour l’intégration sensorielle ; du caractère d’ensemble de l’information dans le cerveau ; et de la base fréquentielle de l’organisation de l’activation et de la désactivation corticales. L’architecture corticale et sous-corticale doit être réévaluée en termes de son rôle dans le maintien de la synchronisation cérébrale à l’échelle microscopique, du fonctionnement en ensembles à l’échelle intermédiaire et des réseaux à l’échelle globale.
Les psychopathologies sont alors comprises, dans leur dimension physiologique, comme des défaillances de la communication interne du cerveau. De telles défaillances peuvent résulter d’une activation inappropriée à certains endroits, d’insuffisances dans la communication au sein des réseaux ou encore d’un couplage inadapté entre différentes fréquences EEG. Ce dernier point a récemment été mis en évidence par un modèle général de « dysrythmies thalamo-corticales ». Ce modèle complète, sans la contredire, la conception neurochimique du dysfonctionnement cérébral. Les modèles neurochimiques à eux seuls sont incapables de rendre compte de la dynamique temporelle du fonctionnement du cerveau ; pour cela, nous devons recourir à des modèles bioélectriques, capables de décrire l’évolution temporelle des événements cérébraux. Une analyse centrée sur les fréquences s’avère donc indispensable.
Le Neurofeedback est dès lors perçu comme un recours aux mécanismes par lesquels le cerveau maintient sa propre synchronisation et gère ses relations de fréquences. Le cerveau doit obéir aux lois qui régissent tout système de régulation. De plus, il assure sa stabilité uniquement à travers des moyens d’autorégulation. Par le biais du conditionnement opérant ou par une stimulation visuelle ou électromagnétique directe, on modifie délibérément l’état instantané du cerveau, sollicitant ainsi ses propres capacités de contrôle pour rétablir la régulation. Le Neurofeedback constitue donc un processus d’apprentissage graduel, au cours duquel le cerveau renforce ses compétences natives d’autorégulation. Cela vaut pour toutes les fonctions soumises à une régulation temporelle, notamment les événements discontinus impliquant le transport synaptique de l’information. On désigne ce principe sous le nom de « Regulatory Challenge » (ou « défi de régulation ») appliqué au Neurofeedback.
Nous sommes en mesure d’utiliser la technique de Neurofeedback avec succès, même avant de comprendre pleinement tous les mécanismes d’autorégulation du cerveau. En effet, on peut concevoir le cerveau comme un système dynamique non linéaire auto-organisé. Grâce à de multiples boucles de rétroaction internes, il est fortement contraint, l’empêchant d’effectuer de grandes « excursions » dans son espace d’états. Lorsque ces écarts se produisent dans un cerveau compromis, ils peuvent être facilement détectés dans l’EEG et servir de rétroaction négative à l’intention du cerveau pour restreindre davantage son comportement. Au fil du temps, un apprentissage se crée et le fonctionnement cérébral s’améliore. Le Neurofeedback peut donc être envisagé comme un « programme de modification comportementale » du cerveau. Grâce à des milliers d’indices par minute, fondés sur une analyse de l’EEG de plus en plus sophistiquée, le cerveau est progressivement orienté vers une meilleure autorégulation. Lorsque l’amélioration se manifeste de façon systématique, on dispose alors de preuves concrètes en faveur de l’hypothèse initiale : la condition étudiée était bien liée à un problème de dérégulation des fréquences ou du rythme cérébral.
On doit comprendre, à la lumière de ce qui précède, les affirmations concernant l’efficacité du Neurofeedback pour divers troubles. Dans certains cas, comme le trouble du déficit de l’attention (TDA) et le syndrome prémenstruel (SPM), nous pensons que la dérégulation est au cœur du problème. Dans le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), par exemple, le mot clé est « trouble ». Il s’ensuit qu’une stratégie d’autorégulation devrait constituer une réponse globale. Par ailleurs, une fois la régulation rétablie, quels que soient les moyens employés, les signes caractéristiques de la condition ne remplissent plus les critères diagnostiques qui en justifiaient l’étiquette.
Dans d’autres situations, cependant, la dérégulation ne fait qu’accompagner un déficit plus structurel. C’est le cas pour l’autisme, le traumatisme crânien ou le syndrome d’alcoolisation fœtale. Dans ces exemples, l’évolution possible est limitée par des contraintes organiques. Malgré tout, la démarche de remédiation semble en règle générale valoir la peine. Enfin, il existe des pathologies dégénératives telles que le Parkinsonisme ou les démences, pour lesquelles l’entraînement par EEG peut permettre de restaurer, puis de maintenir certaines fonctions, en dépit d’une détérioration organique continue. Dans ce genre de cas, l’entraînement doit être poursuivi dans le temps pour préserver les acquis.
Bien qu’il s’applique explicitement à nombre de psychopathologies et de déficits neurologiques, le Neurofeedback est considéré comme non spécifique au niveau diagnostique. Il cible les dérégulations fonctionnelles transversales qui font partie intégrante de la plupart des syndromes cliniques en santé mentale, tout en étant présentes dans les atteintes cérébrales d’origine organique. On peut envisager le Neurofeedback comme une extension de l’approche traditionnelle du biofeedback. Dans le langage courant, on parle simplement de « relaxation », mais d’un point de vue scientifique, il est réellement question d’autorégulation. En agissant directement sur l’EEG, le champ d’action s’étend à toutes les fonctions pilotées activement par le système nerveux central.
Cette conception plus large du Neurofeedback par EEG englobe tout le continuum d’activation-relaxation des réseaux cérébraux de régulation. Il intervient donc sur l’excitation centrale et autonome, sur les réseaux attentionnels, sur certaines fonctions cognitives spécifiques, sur la mémoire de travail, ainsi que sur d’autres formes de mémoire. Il s’applique à la régulation de nos humeurs et de nos émotions ; il agit sur le contrôle moteur ; et il modère notre sensibilité et notre réactivité à l’environnement sensoriel. L’entraînement peut atténuer nos peurs et réguler nos pulsions, qu’il s’agisse de l’appétit, de la recherche de sensations fortes ou de la dépendance aux drogues. Surtout, il peut apporter une stabilité fondamentale au fonctionnement cérébral, en élevant le seuil de vulnérabilité face à des conditions telles que les crises épileptiques, la migraine, les attaques de panique ou les fluctuations bipolaires.
Le Neurofeedback sera peut-être bientôt reconnu, de manière plus générale, comme étant au cœur de la « médecine corps-esprit », dans la mesure où il mobilise le contrôle volontaire pour l’entraînement de processus cérébraux inconscients régulant divers paramètres corporels. Même si le Neurofeedback possède d’importantes implications médicales, il n’est pas, à proprement parler, intrinsèquement un acte médical (bien qu’il le devienne lorsqu’il est pratiqué sous la direction d’un médecin). Il constitue fondamentalement une opportunité d’apprentissage structurée pour le cerveau, laquelle peut être mise en œuvre par différents professionnels de la santé ou de l’éducation. La technique est accessible à tous les âges de la vie, pour autant que le cerveau dispose d’une conscience sensorielle suffisante pour réagir aux renforcements proposés.
En tant que pratique non médicale, le Neurofeedback restera sans doute encore quelque temps classé dans les catégories « médecine complémentaire ou alternative ». Cela restera vrai malgré le fait que les concepts évoqués ici prendront progressivement une place centrale dans notre compréhension du fonctionnement cérébral. La compréhension du « système d’exploitation du cerveau » sera l’une des principales préoccupations de ce siècle, marqué par le développement des neurosciences. Comment une telle compréhension ne pourrait-elle pas avoir de profondes implications thérapeutiques ? En réalité, ces implications sont déjà une réalité concrète.
Bien que notre compréhension reste limitée, sa mise en pratique demeure relativement simple. Il suffit en effet de savoir comment indiquer au cerveau, à chaque instant, la direction d’une performance améliorée ; or, dans la plupart des cas, cela s’avère peu complexe. Nous surveillons simplement la trajectoire du cerveau dans « l’espace des états » au cours de l’instant passé, et nous le récompensons lorsqu’il se déplace vers les zones les plus fréquentées de cet espace, tout en le dissuadant de migrer vers les marges de la répartition. Nous encourageons le cerveau à se diriger vers un état de plus grande complexité, aussi appelé « dimensionalité supérieure ». Ces régions de l’espace des états sont intrinsèquement plus stables. De façon surprenante, le cerveau tire parti de ces signaux et modifie progressivement ses habitudes. La vie quotidienne renforce ensuite le comportement acquis de sorte que les compétences d’autorégulation se maintiennent.
Nous invitons le lecteur à consulter périodiquement ce site pour suivre les nouveautés dans ce domaine passionnant de la recherche et de la pratique clinique : celui de la correction fonctionnelle des troubles de la dérégulation et du champ de l’autorégulation bioélectrique. Ceux qui connaissent déjà ce secteur sont convaincus que la communauté naissante de professionnels en Neurofeedback est à l’avant-garde de la santé mentale et de la performance cognitive optimale.
Nous avons élaboré une brève bibliographie contenant des articles scientifiques sur le Neurofeedback (PDF de 92 pages).
Nous avons élaboré une brève bibliographie contenant des articles scientifiques sur le Neurofeedback (PDF de 92 pages).